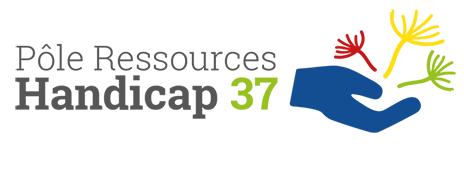Le confinement impose de vivre isolé, loin les uns des autres. Certains sont plus armés psychologiquement que d’autres pour affronter cette situation inédite et déclencher un processus de résilience, explique le psychiatre Boris Cyrulnik (1).
Actualités sociales hebdomadaires : Peut-on faire le deuil d’un proche quand on ne peut pas aller le voir, l’accompagner, comme c’est le cas avec le coronavirus ?
Boris Cyrulnik : Oui, on peut faire le deuil. Mais il est pathologique, comme l’appelle la psychanalyse. Depuis Néandertal, les êtres humains font des sépultures. Quand il n’y en a pas, le deuil existe, mais on ne cicatrise pas. Ou mal. Laisser mourir tout seuls un père ou une mère aimés peut provoquer un grand désespoir pendant longtemps. On a honte. Donc on est contraint de faire un rituel du deuil pour que le corps de ce proche soit respecté et que l’on puisse retrouver notre dignité. Selon les cultures et les religions, il y a des tombes ou pas ; en Asie, on peut brûler les corps. Mais le principe reste le même : il faut qu’il y ait un rituel. A défaut, on se sent coupable même si, bien sûr, on ne l’est pas. Dans la mémoire, le cœur, la personne vit encore et pourtant on l’a abandonnée. Et quand on ressent un sentiment de culpabilité, on expie, on se punit, ce qui peut engendrer des comportements d’échec, plus ou moins conscients. Pour limiter le malaise, il faut inventer un rituel du deuil adapté à cette mort nouvelle imposée par le confinement et déréalisante puisqu’on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé. On nous dit que la personne n’est plus là mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Si le lien avec elle était fort, on peut avoir du mal à se remettre de l’impression de l’avoir trahie. Parler du défunt, raconter sa vie à ses petits-enfants, disposer des photos, faire des prières si on est croyant… sont des ersatz de rituels nécessaires.
Faut-il craindre, à l’issue de la crise, une décompensation chez les personnels soignants qui accompagnent les personnes dans les hôpitaux et les Ehpad ?
B. C. : Cela avait déjà commencé avant. Il y a beaucoup de dépressions professionnelles et de burn-out chez les soignants à cause de leurs conditions de travail difficiles, mais aussi dans les services confrontés à la mort, par exemple en oncologie pédiatrique. Ils paient très cher et depuis longtemps, et cela risque de s’aggraver avec la crise actuellement. Face aux situations très douloureuses qu’ils traversent, il va leur falloir du soutien individuel et collectif.
Quels peuvent-être les effets de la crise sur la population générale ? En Chine, les troubles dépressifs auraient doublé…
B. C. : Le confinement provoque des angoisses et fait perdre tous les mécanismes équilibrants de la vie quotidienne. On le voit déjà avec les enfants qui commencent à regretter l’école, car ils quittaient leurs parents, retrouvaient leurs copains et avaient leurs petites aventures. On les prive de quelque chose de stabilisant : la rencontre avec les autres. C’est pareil pour les adultes. Quand on travaille, on retrouve des collègues, on rentre chez soi fatigué mais on a le sentiment d’avoir passé une bonne journée. On ne peut pas vivre sans les autres, même quand c’est en conflit. Mais, actuellement, c’est ce qu’on nous demande de faire. On perd des mécanismes de régulation. Le téléphone, Skype, les sms, les lettres sont plus précieux que jamais. Après, tout dépend de la manière dont on était construit avant le trauma. Les personnes qui ont acquis des facteurs de protection avant le confinement, qui ont un réseau amical et intellectuel, des facilités à parler, qui savent utiliser les outils numériques vont mieux affronter et supporter le confinement. Si l’on a des liens d’attachement sécurisants, des ressources internes, si l’on a appris le plaisir de la lecture, de la musique, de la cuisine, on va les mettre en jeu pour tenir le coup jusqu’à la fin de l’isolement. Lorsqu’il sera terminé, on va déclencher un processus de résilience facilement. En revanche, si, avant, on a acquis des facteurs de vulnérabilité (maltraitances, maladies, violences conjugales, traumas, précarité sociale…), on se retrouve fragilisé et dans des situations beaucoup plus angoissantes. Le confinement peut réveiller des blessures gardées en mémoire. Si l’on n’est pas soutenu à son issue, le phénomène de résilience sera à peine possible et il y aura beaucoup de difficultés psychologiques. Le confinement est une protection physique et une agression psychique. Les psychiatres reçoivent d’ores et déjà beaucoup d’appels de gens désemparés.
Le confinement peut-il accentuer nos névroses ou, au contraire, être un vecteur de changement ?
B. C. : Il y a beaucoup de couples qui se croyaient en équilibre car ils travaillaient tous les deux. Ils se voyaient quelques heures et le week-end, se parlaient à peu près gentiment, et tout allait bien comme ça. Les problèmes n’étaient pas soulevés. Avec le confinement, tout ce qui était enfoui, dissimulé par l’activité sociale, va s’exprimer. Les séparations sont en augmentation en Chine. De même, les violences conjugales ont flambé en France dès le début du confinement, au point qu’en quelques jours le 119 a été submergé et qu’il a fallu ajouter une autre ligne, le 114. Avant, la protection était de ne pas être l’un avec l’autre tout le temps. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. A l’inverse, on peut observer une activation de l’attachement dans certains couples qui apprennent à avoir une relation plus agréable, à se redéclarer leur amour et combien l’autre est important. Des petites choses qu’on néglige habituellement mais qui sont essentielles. Nous avons des capacités d’adaptation insoupçonnées, c’est ce qui caractérise le monde vivant. Collectivement, le confinement va être un vecteur de changement. C’est une obligation. Si l’on n’en tire pas les leçons et que l’on continue à vivre comme avant, dans un ou deux ans, on aura à nouveau une pandémie. C’est ce qui s’est passé à l’époque des épidémies de peste, où les processus en cause dans la propagation du bacille ont été maintenus, les épidémies se sont répétées et ont tué un Européen sur deux après 1348. Ou alors on apprend à vivre autrement en changeant notre manière de se nourrir, de voyager, de faire de l’industrie. Se reconstruire après un traumatisme, c’est la définition de la résilience.
Cela veut-il dire que nous devons repenser notre manière de vivre ensemble ?
La surconsommation et l’hypermobilité sont à la source de la contamination par les virus. Ces derniers ne se déplacent pas, c’est nous qui circulons. On voit déjà apparaître de nouvelles formes de solidarité, de spiritualité, des voix s’élèvent pour dire qu’il faut ralentir, arrêter de foncer et d’abîmer la condition humaine. Tout cela existait, mais je crois que cela va se renforcer avec l’expérience du coronavirus. Beaucoup de citoyens vont se remettre en cause. Ce sont les catastrophes qui nous font évoluer. Il y aura sûrement des bouleversements profonds. La hiérarchie des valeurs va changer, c’est inévitable. Pour la première fois, la vie humaine est passée avant la rentabilité. Nous faisons face à un défi mental, social et parfois physique dont nos sociétés devraient sortir transformées.
(1) Psychiatre connu pour avoir vulgarisé la notion de « résilience », Boris Cyrulnik a publié en 2019 son dernier livre, La nuit, j’écrirai des soleils (éd. Odile Jacob).